Analyses d'ouvrages
2001: Stratégie marketing des services d'information : bibliothèques et centres de documentation
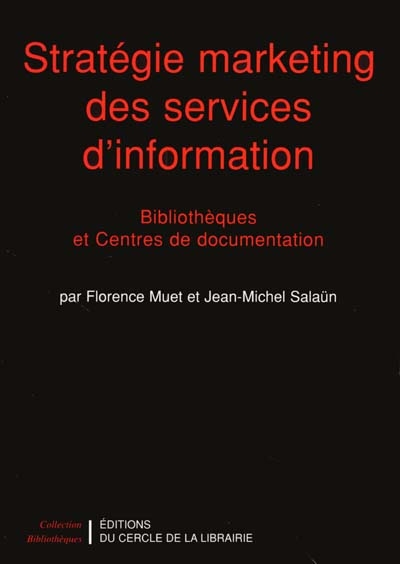 par Florence Muet et Jean-Michel Salaün
par Florence Muet et Jean-Michel Salaün
Paris : Editions du Cercle de la librairie, 2001.
(Bibliothèques).
Bibliogr.- ISBN 2-7654-0794-0
Nouv. éd.
En 1992, Jean-Michel Salaün, professeur à l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques (ENSSIB), a publié la première édition de cet ouvrage intitulé Marketing des bibliothèques et des centres de documentation. Une démarche s'esquissait qui demandait à être précisée. Pour écrire cette nouvelle édition, en 2001, l'auteur s'est adjoint Florence Muet, consultant en développement des services d'information. Le titre a été modifié pour s'adapter à la situation actuelle et la méthode a été enrichie et approfondie.
La première partie s'intitule " Le diagnostic ". Qu'est-ce que l'application d'une démarche marketing en bibliothèque ou en centre de documentation ? Elle va permettre de faire des choix stratégiques, de prendre des décisions qui se fondent sur une réalité précise. Il est nécessaire, dans un premier temps, de délimiter clairement le champ sur lequel il faut travailler : la bibliothèque ou le centre de documentation ; un département ou un service ; un réseau documentaire. Vient ensuite l'étape d'analyse interne où les atouts et les faiblesses du service étudié vont être dégagés : les moyens (humains, financiers, matériels), l'activité (offre, service aux utilisateurs, service interne), la gestion (organisation, politique) sont analysés. A l'analyse interne, succède l'analyse du public. Les critères d'analyse prennent en compte les caractéristiques sociologiques, informationnelles, comportementales (ce qui permet ensuite la définition de critères de segmentation) ainsi que le volume du public concerné, selon que celui-ci appartient à la catégorie lecture publique, enseignement ou documentation. Les méthodes d'analyse du public avec un exemple d'enquête sont précisées. Puis, l'analyse externe du service va dégager les opportunités et les menaces éventuelles ; elle s'appuie sur les tutelles, les partenaires et la conjoncture. Suite à ces différentes analyses, quel diagnostic peut-on tirer ? Les auteurs préfèrent parler de vue d'ensemble et non de diagnostic à cette étape de leur raisonnement. L'efficacité du service peut être mesurée et il est possible de constater l'adéquation avec sa mission originelle.
Cependant, pour passer du diagnostic à la stratégie, les différents éléments positifs ou négatifs pour le développement de la bibliothèque ou du centre de documentation vont être hiérarchisés (éléments principaux, secondaires, accessoires).
La seconde partie " La stratégie " permet, dans un premier temps, de clarifier la mission du service : faut-il la redéfinir, en préciser les termes ? Dans un deuxième temps, la construction stratégique s'appuie sur un schéma circulaire entre ciblage, offres de services et positionnement. En précisant les objectifs à atteindre (que ceux-ci soient d'ordre quantitatif, qualitatif ou intellectuel), la mise en œuvre envisagera différents scénarios de développement et leur financement. Le ciblage concerne les publics visés et les méthodes de marketing proposées (marketing indifférencié, concentré, adapté, différencié, personnalisation) pour dégager des objectifs quantitatifs de développement. Fidélisation, attraction, limitation sont les trois logiques offertes. L'offre de services dégage les niveaux de service et permet de s'interroger sur les différents rôles du service d'information : rôle de facilitation, de pédagogie, de coproduction, de sous-traitance. Un contrat est alors passé avec le public ; une tarification des services est proposée. L'offre de service fait l'objet d'une communication vers le public visé. Le positionnement du service est le troisième maillon du schéma circulaire indiqué précédemment. Plusieurs adjectifs précisent ce que doit être un bon positionnement : réaliste et explicite ; fort et original ; cohérent. Les auteurs préconisent la traduction en un seul concept du positionnement adopté. En conclusion à cette deuxième partie, un certain nombre de scénarios sont proposés avec des exemples de financement et de planification.
Afin d'illustrer de manière concrète la méthode énoncée, trois études de cas détaillées sont ensuite proposées en fin d'ouvrage.
Par rapport à la première édition, l'ouvrage actuel de JM Salaün et de F. Muet s'est considérablement enrichi et étoffé. La démarche exposée est claire, didactique, de nombreux tableaux synthétisent les différentes options ou propositions faites, les études de cas en fin de volume illustrent fort à propos ce qui a été dit. Les documentalistes trouveront là matière à réflexion pour améliorer leur service et de nombreuses réponses à leurs interrogations concernant le positionnement du service ou à la manière de toucher leur public. C'est également une vision très actuelle de la documentation et des bibliothèques qui nous est offerte : les professionnels de l'information trouveront là des méthodes pour mieux évaluer leur service, le rendre plus performant et en meilleure adéquation avec les attentes de l'entreprise d'une part et de leur public d'autre part.
Critique parue dans Documentaliste, sciences de l'information, 2001, vol. 38, n° 5-6 , pp. 341-342.
Cop. JP Accart, 2007

LinkedIn