Analyses d'ouvrages
2022 - Agir pour l'égalité. Questions de genre en bibliothèque
Agir pour l’égalité. Questions de genre en bibliothèque, sous la direction de Florence Salanouve. Villeurbanne : Les Presses de l’Enssib, 2021. (La Boîte à Outils #50). ISBN 978-2-37546-138-9. 22 euros ; PDF : 12.99 euros.
Si un sujet est prédominant dans la société actuelle, ce sont bien les questions du genre et de l’égalité homme-femme : presse, magazines, livres et publications diverses, reportages ou réseaux sociaux s’en emparent avec une certaine avidité. Cet intérêt qui ne se dément pas sur la durée correspond à un réel besoin d’apprendre, de comprendre et de trouver des solutions d’amélioration à ce sujet sensible. C’est donc tout à l’honneur de la collection Boîte à outils des Presses de l’Enssib de le mettre en exergue par rapport aux bibliothèques. En effet, beaucoup de questions ou de constats sont posés quand on parle de genre en bibliothèque : pourquoi une profession autant féminisée ? pourquoi les études attirent-elles peu d’hommes, sauf en ce qui concerne le diplôme de conservateur/trice ? pourquoi autant de stéréotypes autour de la figure du/de la bibliothécaire ?
Pour ma part, de nombreuses réponses ou hypothèses peuvent être avancées : une profession moins reconnue que dans d’autres pays (le contexte est ici la France) ; la question des salaires ; un métier assimilé à du secrétariat donc forcément féminin… La question du genre en bibliothèque se pose très différemment dans d’autres pays d’Europe : pour donner l’exemple de la Suisse, la profession est beaucoup moins féminisée, elle attire les candidats masculins et pas forcément dans des rôles de cadre. Dans les pays scandinaves également, la question du genre semble moins se poser.
Florence Salanouve, conservatrice de bibliothèque, dirige avec maestria cet ouvrage et convoque dix-huit auteurs-trices (un seul homme cependant) pour développer le concept « d’agir pour l’égalité » : le propos est donc riche, et ne peut être recensé intégralement. Seuls quelques points, les plus saillants, vont être relevés.
Dans le Mode d’emploi qui introduit et explique l’ensemble de l’ouvrage, F. Salanouve évoque deux autrices sur la question féminine : Virginia Woolf et Susanne Briet. La première, dans Une chambre à soi, décrit une expérience désagréable quand elle se voit refuser l’entrée d’une bibliothèque qui n’accepte pas les femmes (ou alors accompagnée d’un membre du collège ou d’une lettre de recommandation) ; et la seconde, qui fut une des premières femmes à travailler à la Bibliothèque nationale de France en 1924 (après l’obtention du diplôme du CAFB) et qui subit alors un certain nombre de propos réprobateurs de la part de ses collègues masculins qui composaient alors l’essentiel des effectifs. C’est donc une forme de ségrégation qui est relatée dans ces deux cas. F. Salanouve mentionne sa propre expérience de jeune conservatrice, systématiquement prise pour une stagiaire… Elle détaille ensuite plusieurs points qui permettent de mieux comprendre l’orientation générale du livre : les bibliothèques n’échappent pas à la question du genre qui traverse par ailleurs toute la société. La question est loin d’être réglée.
Il s’agit bien d’un rapport de pouvoir comme l’analyse l’historienne américaine Joan W. Scott, et pour aller plus loin, la bibliothèque, au travers de sa politique de collection ou comment elle recrute, est le reflet de ces inégalités selon Bess Sadler et Chris Bourg.
Comment les professionnel.le-s vivent-il.elles ce sujet sur le terrain ? Ce sont les témoignages récoltés ici qui répondent à cette question dans la première partie : le rôle du/de la bibliothécaire aujourd’hui (Chloé Jean) ; l’engagement et la neutralité (avec Camille Hubert, Thomas Chaimbault-Petitjean) ; la notion d’égalité (Réjane Sénac) ; la féminisation du métier (Anne-Marie Pavillard) sous un angle historique ; la gestion de projet sur la question du genre (Amandine Berton-Schmitt) ; une expérience à la BUA – Université d’Angers ( Elisabeth Collin-Santo, Maud Puaud). La deuxième partie aborde la question de la classification qui n’est pas neutre en matière de genre (F. Salanouve) ; les archives féministes (Annie Metz, Nathalie Clot) ; le genre dans la littérature jeunesse (Sylvie Cromer) ; les étagères roses de la bibliothèque publique d’Amsterdam (Camille Hubert).
La troisième partie expliquent les actions de communication sur différents territoires et entre organismes : à St Quentin-en-Yvelines (Armel Dubois-Nayt) ; à Strasbourg ( Estella Peverelli) ; au sein de l’Association des bibliothécaires de France (Thomas Chaimbault-Petitjean) ; des bibliothèques militantes (Chloé Jean) ; les femmes dans Wikipedia (Carole Renard) ; à Rennes (Aénor Carbain). Enfin, un mémento est dessiné, à sa manière habituelle, par Magali Le Gall.
Vivant et dynamique, le propos de cet ouvrage, très résumé ici, devrait répondre à un certain nombre d’interrogations sur ce sujet loin d’être neutre. Pour les raisons invoquées au début, les bibliothèques sont un vrai terrain d’étude, et nombre de professionnel-le-s devraient trouver source d’inspiration et de réalisation.
cop. jpaccart
Publié dans la revue belge francophone Lectures-Cultures n° 29, septembre-octobre 2022, p. 88-89
Copyright
L'utilisation des images et des textes du site requiert l'accord écrit de Jean-Philippe Accart et doit mentionner les données relatives aux droits d'auteur. Ce site suit les règles européennes du RGPD.
Cop. 2026

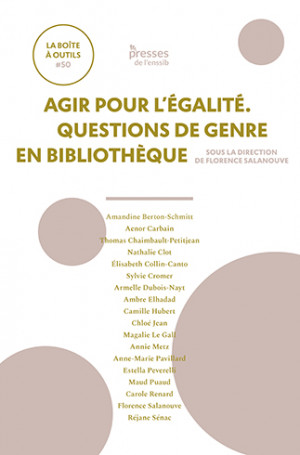
LinkedIn