Ouvrages collectifs
1999 - La société de l'information et les nouvelles formes de travail
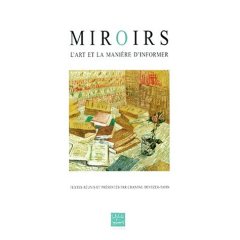 In Miroirs, l'art et la manière d'informer, éd. par C. Dentzer-Tatin. Paris : ADBS, 1999. pp. 59-70.
In Miroirs, l'art et la manière d'informer, éd. par C. Dentzer-Tatin. Paris : ADBS, 1999. pp. 59-70.
Comment travaillerons-nous demain ? Quelles nouvelles formes de travail s'offriront à nous, documentalistes ? La société de l'information est prometteuse d'avenir pour les professionnels de l'information, mais tiendra-t-elle toutes ses promesses ? Il est difficile, à l'heure actuelle, de dresser des perspectives à long terme, mais il est nécessaire, en regard de ce qui se profile à l'aube d'un siècle nouveau, de s'interroger, d'essayer d'entrevoir ce que sera notre futur.
L'apport de la société de l'information
Certains chercheurs comparent la transformation technologique actuelle par son ampleur à l'invention de l'alphabet par les Grecs (700 ans av. J.-C). Pour la première fois une véritable interaction est trouvée entre les différents modes de communication écrit, oral et audiovisuel, auparavant séparés.
La révolution technologique de cette fin du XXème siècle, centrée sur l'information, change les modèles traditionnels de la société par un rythme de plus en plus accéléré de la circulation de l'information. Un nouveau système de communication fondé sur la convergence avec d'autres technologies est ainsi organisé : la numérisation du texte, de l'image et du son alliée aux nouveaux modes de transmission permet une diffusion instantanée et universelle de l'information. La société de l'information conjugue l'infrastructure des télécommunications, celle des connaissances et celle dite "d'intégration" désignant les normes facilitant les échanges.
L'activité humaine se transforme dans tous ses aspects : individuelle, sociale, culturelle, technique, productive, commerciale, ...
Généralités sur le travail à la fin du XXème siècle
L'économie, la mondialisation, la précarité, les délocalisations d'entreprises sont autant de facteurs qui bouleversent l'emploi et le marché du travail classiques. Tout individu doit s'adapter pour survivre à ces changements, il doit envisager de suivre un parcours professionnel soumis à des variations et de changer plusieurs fois de métier, de profession ou tout du moins de l'exercer de manière différente. Qu'en sera-t-il du documentaliste dans vingt ans? L'information continuera-t-elle à être centralisée dans un lieu unique ou sera-t-elle diffusée partout, sans limitation de frontières grâce à Internet comme cela se profile déjà dans certains cas ? Quel sera le rôle réel du documentaliste du futur ?
L'apparition de nouvelles formes de travail
De nouvelles formes de travail naissent de la société de l'information (travail à distance, télétravail, travail en réseau, travail coopératif, ...). Cependant l'impact de la technologie sur l'organisation du travail est à mettre en relation avec l'environnement (culturel, institutionnel) de l'entreprise. Les effets de la technologie sont assez sensiblement les mêmes dans les usines, les bureaux et les organisations de services ; l'appropriation de l'outil informatique permet aux travailleurs de ne plus se concentrer uniquement sur des tâches répétitives.
L'étude générale des nouvelles formes que prend le travail peut apporter une réponse à toutes les questions qui se posent.
Différents types d'emplois se développent. Ils impliquent une "relocalisation" du travail facilitée par l'utilisation combinée des technologies de l'information et de la communication :
- les formes individualisées : le travail s'effectue loin des locaux de l'employeur, il peut être localisé chez soi, être mobile ou délocalisé en plusieurs endroits,
- les formes collectives : le travail s'exerce dans des locaux extérieurs, est contrôlé par un employeur. Elles comprennent :
- la relocalisation des fonctions des services internes de l'entreprise vers des sites éloignés ayant leur spécificité fonctionnelle, pouvant être des bureaux satellites ou des centres d'appel (c'est le cas du télésecrétariat, du téléarchivage, de la télétraduction),
- la sous-traitance du travail vers des "telecottages" (en anglais) d'autres organisations, également connus sous la dénomination de "télécentres", "centres de ressources extérieures", " centres communautaires de ressources ", "centres de ressources informatiques " ou " bureaux d'études ou de voisinage ",
- le développement du travail d'équipe redistribué grâce à l'aide de l'outil informatique. Le travail à réaliser est organisé sur plusieurs sites permettant une meilleure répartition des fonctions qui, auparavant, étaient centralisées sur un seul site indépendant,
- l'utilisation des réseaux électroniques pour développer des relations de collaboration entre entreprises, créant ainsi de nouvelles formes de liens et des partenariats ; ces entreprises sont parfois appelées "entreprises virtuelles".
Des options nouvelles d'organisation du travail
L'introduction des nouvelles technologies en matière d'information et de communication (NTIC) permet l'ouverture de nouvelles options au sein de l'organisation du travail. Un des exemples les plus frappants en la matière est la nouvelle génération de salariés "sans bureau fixe" telle qu'elle est conçue dans des sociétés comme Andersen Consulting : les employés ne disposent plus d'un bureau personnel, mais d'une plage horaire pour se rendre au travail à certains moments de la semaine ou du mois et y occuper un bureau...temporaire. Constamment relié par un téléphone et donc joignable rapidement, l'employé possède un micro-ordinateur portable lui permettant d'accéder au réseau de son entreprise et à Internet. La société dégage ainsi des gains significatifs en n'occupant pas des locaux importants et le travail s'en trouve considérablement modifié. D'autres sociétés telles IBM, Bull, Hewlett Packard, Axa expérimentent ces nouvelles formes de travail.
Directement ou indirectement, les nouvelles technologies en matière d'information et de communication induisent des changements dans :
- la localisation du travail,
- l'organisation des heures de travail,
- la combinaison de compétences différentes exigées pour des tâches bien précises,
- les arrangements contractuels,
- les structures organisationnelles.
Le "télétravail " par son adaptabilité et sa souplesse représente la forme type de cette nouvelle organisation du travail.
Le travail en réseau : quelques statistiques Les Etats-Unis ont essayé d'estimer le nombre de travailleurs en réseau (télétravailleurs) à partir de la fréquence des installations informatiques chez les particuliers et de ses usages déclarés. (op. cit. HUWS U., Teleworking, an overview of the research, London, Analytica, 1996) |
Les conséquences économiques et sociales
Ces nouvelles formes d'organisation du travail prennent un essor plus ou moins grand selon les pays. La France marque un retard malgré le désir d'un certain pourcentage de la population d'y accéder. Globalement, on compte près de 215 000 télétravaileurs en France en 1998 et quelques télécentres. Travailler chez soi ou dans un télécentre près de son domicile présente des avantages et a des conséquences économiques, sociales et humaines :
- les conséquences économiques :
- la réduction de la consommation d'essence et de l'utilisation des transports (voiture personnelle ou transports en commun),
- la diminution de la circulation routière par l'utilisation des télécommunications,
- les effets positifs sur l'économie de l'énergie et l'environnement,
- l'amélioration des infrastructures de télécomunications,
- le développement des services à domicile.
Le télétravail promet de devenir un important instrument améliorant la concurrence et générant de nouvelles opportunités commerciales et d'emploi : les technologies impliquées forment la base de nouvelles industries et services, la productivité et l'efficacité des entreprises sont améliorées, de nouvelles formes de travail en équipe, de collaboration, et de "télépartenariats" sont créées ; une relocalisation du travail dans des zones économiquement défavorisées est facilitée par la diversification des économies locales devenant ainsi plus flexibles.
- les conséquences sociales et humaines sont de plusieurs ordres : conséquences sur les horaires de travail, sur le chômage, sur le développement des services, sur la productivité et sur l'égalité des chances :
- la restructuration des horaires de travail peut être facilitée, permettant d'introduire des formes plus flexibles de travail tels le temps partiel ou le partage du travail,
- la productivité des travailleurs à distance (ou télétravailleurs) s'accroît augmentant d'environ 20%. Un télétravailleur produit un rapport plus rapidement qu'un collègue travaillant dans un bureau,
- le chômage est réduit et amène sur le marché du travail des groupes d'individus qui en étaient exclus parce qu'ils n'étaient pas en mesure de travailler à temps complet.
- les nouvelles technologies apportent des améliorations dans la qualité de la vie par l'introduction de nouveaux services tels la télémedecine, la télémaintenance, les services bancaires à distance et les achats à distance.
Cela peut inclure également une plus grande utilisation de l'enseignement à distance basé à la maison, le videotex et les activités de loisirs à domicile utilisant des applications informatiques multimedia.
On peut prévoir une plus grande utilisation du travail basé à domicile, des téléconférences et de l'échange électronique des données.
L'égalité des chances ouvre d'autres possibilités :
- les personnes souffrant de handicaps représentent des groupes pouvant énormément bénéficier des nouveaux avantages offerts par le travail à distance et l'ouverture qu'offre le télétravail,
- l'égalité des sexes : sans la possibilité d'être des télétravailleuses, bien des femmes n'auraient pas du tout accès au monde du travail : elles peuvent combiner ainsi leurs responsabilités familiales avec un travail effectué à domicile, ce système permettant une grande flexibilité d'horaire.
- un gain en "temps social" offre plus de loisirs et permet d'avoir d'autres activités (culturelles, sportives, familiales etc, ...). La notion de "temps social" est à souligner car elle correspond à une aspiration de plus en plus grande de la société actuelle.
Cependant, on distingue quelques points négatifs :
- la "désocialisation" des travailleurs à distance car ils ne fréquentent que de façon épisodique leur entreprise et n'ont pas le sentiment d'appartenance,
- les perspectives de promotion sont moindres avec le télétravail et les niveaux de salaire sont moins élevés que ceux offerts sur un même site.
Les nouvelles formes de travail en documentation
Informatique et innovation
Depuis une quinzaine d'années, l'informatique documentaire a beaucoup évolué et facilité le travail et son organisation : les tâches répétitives que sont le bulletinage, la gestion des prêts, le récolement sont automatisés.
Le service de documentation peut accéder maintenant &agra
e; de nouvelles ressources documentaires, véritables gisements ou réservoirs bibliographiques, ce qui était inconcevable auparavant et proposer des produits et des services mieux adaptés à ses utilisateurs. Le travail devient plus flexible. L'innovation est rendue possible par la conception de produits documentaires personnalisés apportant ainsi une réelle valeur ajoutée au travail. Le concept de veille, dans ses formes diverses (veille technologique, concurrentielle, juridique, économique, géopolitique, sociétale, ...), est le résultat d'un tel processus.
Les technologies de l'information constituent l'élément principal du travail et ont des effets sur l'innovation ; elles autorisent une certaine souplesse dans le travail et permettent d'intervenir plus facilement et plus rapidement en cas d'erreurs.
Les technologies de la communication qui y sont intégrées modifient radicalement le processus habituel de production et de diffusion de l'information. La communication entre les différents partenaires (entre documentalistes, entre l'utilisateur et le documentaliste) est grandement facilitée : par la messagerie électronique, l'envoi de bibliographies, le partage des ressources.
Le documentaliste et les réseaux de l'information
L'organisation de l'information sur les réseaux, Internet par exemple, suppose une maîtrise de plus en plus grande des contenus : même si le principe d'échange préside à la philosophie du réseau, il peut y avoir une réelle déperdition d'information (sur-information, sous-information) entraînant un manque de pertinence dans les réponses. L'information en ligne nécessite une organisation rationnelle au même titre qu'une collection de revues, d'articles ou de livres sur les rayonnages d'un service de documentation. La facilité d'accès au réseau ne doit pas masquer la multiplicité des pistes et la difficulté de trouver la bonne information : les outils de navigation, d'indexation automatique existent mais ne peuvent remplacer complètement un professionnel formé aux techniques dont le rôle est de trier, sélectionner et organiser l'information. Internet doit être pour l'utilisateur un moyen et un réseau "utile" ; le documentaliste est mieux armé que quiconque pour proposer à partir d'un site des liens vers d'autres sources et retrouver l'information pertinente. Les banques de données documentaires accessibles sur le réseau sont de plus en plus nombreuses : le documentaliste confronte les différentes sources, les compare et construit des systèmes de référence, qui deviennent de véritables bibliothèques sélectives en ligne.
Bien que l'imprimé soit toujours présent, l'information électronique tend à prendre une place prépondérante dans la vie professionnelle : numérisation des documents, des formulaires administratifs, réception de fichiers via les réseaux, modification de documents directement à l'écran, consultation de cédéroms, ... L'interactivité est présente à toutes les étapes. Placé au coeur du système d'information, le documentaliste possède un savoir qui permet des recherches fines, des échanges et l'exploitation des flux d'information. Il doit transposer son savoir-faire dans un monde virtuel, sans frontières où l'hétérogénéité domine.
La coopération entre documentalistes
Les liens entre professionnels se multiplient grâce aux réseaux de l'information : messagerie électronique, échange d'informations, prêt entre bibliothèques, envoi de bibliographies, dépouillement partagé de revues, listes de discussion. Les réseaux modifient les comportements et les manières de travailler. De plus en plus le travail des documentalistes devient un travail coopératif. L'appartenance à la profession, grâce à la coopération, se renforce.
Quelques tendances pour l'avenir
Le métier de documentaliste subit les mêmes évolutions que le travail dans son ensemble. De nouvelles formes d'emploi apparaissent :
- le télétravailleur ou travailleur à domicile : le travail documentaire (synthèses, résumés, traductions, recherches sur les réseaux) peut s'exercer un jour ou deux par semaine à partir du domicile. Peu d'entreprises, à l'heure actuelle, ont recours à cette forme d'emploi : le documentaliste peut la proposer à sa hiérarchie, arguant du fait qu'il est à même de réaliser plus rapidement un certain nombre de travaux tout en restant connecté de façon permanente à l'entreprise ou avec ses collègues directs. L'installation à son domicile d'un matériel performant, une organisation clairement définie dans le service de documentation et un contrat précis définissant les heures de présence et les obligations du salarié sont nécessaires. Même si la charge de travail reste la même, il apparait que le travail réalisé à domicile est optimisé par une économie de transports et un stress moindre,
- le travailleur à temps partagé : il exerce une pluriactivité et demande une nouvelle organisation du travail. Des petites entreprises peuvent employer un documentaliste pour des tâches spécifiques contractuellement bien définies. Ainsi, un même documentaliste peut avoir plusieurs contrats avec plusieurs entreprises : il peut être chargé de cours, organiser des stages de formation. Toutes ces formes de travail sont autant de facettes d'un même métier,
- le travailleur indépendant : certains documentalistes choisissent de s'installer en libéral après quelques années d'exercice. L'insertion dans un réseau professionnel est primordial pour la réussite d'un tel projet. Le statut de travailleur indépendant est différent de celui du salarié et correspond à des aptitudes particulières d'autonomie et de liberté,
- le consultant : des cabinets de consultants en documentation existent depuis une dizaine d'années, constitués d'équipes de documentalistes allant de deux à dix, voire plus, professionnels. Les entreprises s'adressent à eux pour des missions ponctuelles (élaboration d'un thésaurus, mise en place d'une base de donnée, audit interne etc, ...) Cette forme de travail indépendant tout en étant intégré au sein d'une équipe est très prisée : le fonctionnement se rapproche du secteur privé. La notion de réseau professionnel est importante également. L'Association des professionnels de l'information et de la documentation (ADBS) diffuse une liste de consultants en documentation (site Internet de l'ADBS),
- le travailleur mobile : la flexibilité du marché du travail conduit les travailleurs à être plus mobile, à changer de lieux de travail plusieurs fois au cours de leur vie professionnelle. La mobilité professionnelle se développe sur le plan hexagonal, mais également européen. Les professionnels de l'information qui parlent plusieurs langues étrangères peuvent être amenés à travailler dans un pays de l'Union. Le projet DECID (Développer les Eurocompétences pour l'Information et la Documentation), soumis par l'ADBS à la Commission européenne dans le cadre du programme Leonardo da Vinci sur la formation professionnelle, devrait aboutir à un système de certification européen des professionnels de l'information. Le projet DECID a été retenu par la Commission parmi 1981 propositions.
Ces nouvelles formes de travail, de par les grandes tendances qu'elles dégagent (souplesse, flexibilité, mobilité) permettent d'entrevoir quelle peut être la réalité de demain pour le documentaliste. La profession vit à l'heure actuelle une mutation importante dûe à plusieurs facteurs concomittants.
Non content de voir évoluer son environnement et son outil de travail, le documentaliste doit également s'adapter et adapter ses compétences de manière quasi permanente. C'est un enjeu important qui demande des qualités de souplesse et d'appropriation rapide. Nul doute que la société de l'information ouvre un avenir prometteur pour le métier de documentaliste.
Quelques définitions
|
Bibliographie
ACCART J.P., "Internet et les réseaux : nouvelles formes de travail", Le Micro Bulletin du CNRS, 1998, 73, 80-87
BERARD D., VEAUX S., Le Télétravail : dossier documentaire, Lyon, ANACT, 1996
CASTELLS M., La société en réseaux. Vol. 1 : L'ère de l'information, Paris, Fayard, 1998
GILLEPSIE A., Review of Telework in Britain : Implications for Public Policy, Centre for Urban and Regional Development Studies, Newcastle upon Tyne, 1995
HUWS U., Teleworking, an overwiew of the research, London Analytica, 1996
HUWS U., Follow up to the White Paper-Teleworking, European Commission Directorate General V Employment Task Force, September 1994
HUWS U., Teleworking and Gender, draft report to the European Commission's Equal Opportunities Unit, DGV, 1996
ILLINGSWORTH M.M., "Virtual Managers", Information Week, June 13, 1994
Livre vert sur les conséquences sociétales de la société de l'information, Bruxelles, Commission des Communautés européennes, juillet 1996
Livre vert sur le convergence des secteurs des télécommunications, des médias et des technologies de l'information, et les implications pour la réglementation. Vers une approche pour la société de l'information, Bruxelles, Commission européenne, 1997
WARF B., Telecommunications and the Changing Geographies of Knowledge Transmission in the late 20th century, Urban Studies, vol. 32, n°2, 1995, pp 375-376
Cop. JP Accart, 2007

LinkedIn